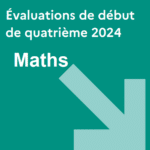A quoi sert le Lycée professionnel pour les politiques publiques de l’éducation? Fabienne Maillard, professeure des Universités en sciences de l’éducation à l’Université de Paris 8, spécialiste de la voie professionnelle et des diplômes, des certifications professionnelles et des relations formation-emploi, nous informe des enjeux institutionnels des réformes du L.P. Elle répond aux questions du Cagé pédagogique
 Le Lycée professionnel est-il un champ très étudié dans les sciences sociales ou dans les sciences de l’éducation ?
Le Lycée professionnel est-il un champ très étudié dans les sciences sociales ou dans les sciences de l’éducation ?
Bien qu’il accueille énormément de jeunes – environ un tiers des lycéens selon les chiffres du RERS, il est à la marge du système éducatif. Comme il a une image de relégation scolaire, en fait il intéresse assez peu les chercheurs qui affirment que c’est très compliqué de l’étudier car il renvoie à beaucoup de diplômes, de secteurs d’activités, de spécialités, des commissions professionnelles consultatives, des acteurs externes puisqu’il y a des stages… On ne peut pas en avoir une vision uniforme. C’est très hétérogène.
Il y a quand même quelques grands axes d’études souvent sur les élèves portés par Prisca Kergoat qui a récemment publié un ouvrage sur l’indocilité des jeunesses populaires en lycée professionnel ou en apprentissage. Séverine De Poilly qui travaille sur le genre et les résistances des élèves. Ces travaux changent le regard, trop souvent centré sur la domination des élèves de LP. Il existe également des recherches sur les curricula, sur la didactique – des maths-sciences – comme Xavier Sido, ou du français avec Marise Lopez. D’autres chercheurs s’intéressent aux modalités de professionnalisation comme Nicolas Divert, Fanny Renard… Les recherches sur le LP sont passionnantes mais le nombre de chercheurs qui s’y intéressent en France est très limité.
Le fait qu’il soit considéré comme une institution de relégation est -il aussi un facteur dissuasif pour les chercheurs ?
Oui. Bourdieu a montré que la relégation d’un objet conduit à la relégation des scientifiques qui travaillent dessus. Pourtant, les travaux que j’ai réalisés sur l’enseignement professionnel m’ont permis de comprendre que les diplômes professionnels expérimentent des tas de transformations qui se diffusent ensuite dans d’autres segments du système éducatif. C’est ce qui a lieu dans l’enseignement supérieur depuis que tous ses diplômes sont dits « professionnels ».
Comme les diplômes professionnels sont des instruments politiques très facilement manipulables, au nom des besoins des entreprises et de leur adéquation à l’emploi, ils expérimentent des tas de réformes qui peuvent se propager : approche par compétences, stages, césure formation/ certification, exclusion de la formation dans les référentiels de certification, découpage en blocs de compétences et en micro-certifications…
De plus, ce qui peut rendre difficile le travail des chercheurs, c’est que l’enseignement professionnel est une institution mouvante parce qu’il connaît des réformes incessantes, qui se sont accélérées ces dernières années et pour les chercheurs, ce changement permanent est difficile à suivre. Il faut avoir une forme de connaissance historique pour comprendre ce qu’il se passe, ce que permettent par exemple les travaux de Guy Brucy ou de Vincent Troger. Mais une réforme par an, comme le promet le Président de la République, c’est très déstabilisant pour les enseignants, les élèves mais aussi pour les chercheurs.
Quelles sont pour vous les réformes majeures du LP ces dernières années ?
Il y en a eu beaucoup, je ne peux pas répondre en peu de temps mais je dirais, l’arrivée du bac professionnel en 1985, qui a restructuré totalement l’architecture de la voie professionnelles. A l’époque le CAP est dans le viseur du ministère qui en diminue les effectifs. Les CAP sont supprimés les uns après les autres puisqu’on est dans une période de désindustrialisation. Le BEP est privilégié pour permettre le développement du bac pro, l’objectif étant d’atteindre 80 % d’une classe d’âge au niveau du baccalauréat. A l’époque l’apprentissage est peu développé, il est concentré sur le CAP. Il vivote mais ne constitue pas, jusqu’en 1987, un axe des politiques éducatives. La loi de 1987 va lui donner un nouvel élan puisqu’elle l’ ouvre à tous les diplômes, jusqu’au diplôme d’ingénieur.
Une autre réforme fondamentale doit être prise en compte, c’est la « rénovation de la voie professionnelle » commencée en 2007 et actée en 2009. Elle supprime le cursus de formation au BEP pour que le bac pro soit préparé en 3 ans et non plus en 4 ans et relance – une nouvelle fois – le CAP. Cela fait que les élèves qui sortent d’un bac pro sont plus jeunes et ne correspondent pas forcément aux attentes des employeurs. Des mesures étranges vont alors être mises en place pour proposer un sas temporel aux bacheliers professionnels, comme proposer des diplômes d’établissement dans des universités, des bacs plus un. Ces diplômes d’établissement, sauf dans le cas des mentions complémentaires, ne sont pas des diplômes nationaux; et ils peuvent sanctionner aussi bien un projet professionnel que des spécialisations quelconques. C’est un changement considérable car la notion de diplôme devient assez floue. Ce qui a des conséquences sur le marché du travail.
Une autre réforme importante est la « transformation de la voie professionnelle » engagée en 2018. Il s’agit de transformer la voie professionnelle par des réformes régulières, une réforme par an a promis le Président de la République. Ce qui est inédit, outre ce rythme intense de réforme, c’est que c’est lui qui annonce les réformes et pas le ministre de l’Éducation, et en plus via les médias et pas via des sources officielles.
Pourquoi une telle stratégie ?
Quand c’est le Président de la République qui annonce ces réformes, c’est que le ministère de l’Éducation et l’administration centrale en l’occurrence, se voit dessaisi de ses missions. L’administration centrale a été dessaisie de ses capacités d’expertise et ce sont des cabinets de conseil privés qui réalisent les études. Ce ne sont pas seulement les enseignants qui voient leurs missions changer, ce sont aussi les missions de l’administration centrale qui sont transformées. Jean-Paul Delahaye, ancien Dgesco, est très clair et très critique sur cette perte d’autonomie du ministère.
Qu’en est-il de cette dernière réforme que vous évoquiez ?
La Transformation de la voie professionnelle contient des arguments légitimes comme transformer l’image du lycée professionnel qui n’est effectivement pas bonne. Après, ce n’est pas la faute des enseignants et des familles. C’est plus certainement parce que le ministère de l’Éducation nationale n’a jamais vraiment donné de valeur à l’enseignement professionnel et l’a souvent considéré comme une filière de relégation, dédiée à la gestion des flux d’élèves en difficultés, scolaires ou autres. Il est clair que les politiques publiques sont responsables de la mauvaise image du lycée professionnel. Donc redorer son image, pourquoi pas ? Mais sans redorer les emplois, statuts, salaires, conditions de travail, carrières… je ne vois pas comment cela peut fonctionner. Ce qui est clairement en jeu dans cette transformation, c’est le développement de l’apprentissage et pas celui de filière scolaire.
Quelles sont les différences entre l’apprentissage et l’enseignement professionnel ?
L’apprentissage relève surtout du privé, puisqu’il y a très peu de CFA publics. Valoriser l’apprentissage, c’est aussi valoriser la privatisation de la formation professionnelle initiale, dans la voie professionnelle comme dans l’enseignement supérieur. On voit bien que ce sont des enjeux de marché. Face à cette marchandisation de la formation professionnelle, on peut légitimement s’inquiéter de l’avenir de l’enseignement professionnel public. Le gouvernement propose de développer des sections d’apprentissage dans les lycées professionnels, ce qui est possible depuis 1993, sauf que cela ne s’est jamais vraiment développé. Cela demande des réorganisations de la formation, des horaires, des salles de cours… Ce sont deux voies de formations différentes : dans la mesure ou les apprentis ont un contrat de travail, leur temps de formation n’est pas celui des élèves et leur temps de vacances n’est pas celui des vacances scolaires. L’apprentissage peut être organisé une semaine sur deux, ou une semaine sur trois, ou quelques jours par semaine, cela peut être extrêmement variable. Et si l’apprentissage est aujourd’hui magnifié par les responsables politiques, on sait néanmoins que les ruptures de contrats y sont nombreuses, avec en moyenne ¼ de ruptures, qui concernent plus souvent les apprentis en CAP ou en bac pro. En plus, l’apprentissage est forcément sélectif puisque ce sont les entreprises qui signent les contrats. Mais il peut être attractif pour les jeunes, qui sont rémunérés. Cependant, lorsqu’il ne dispose pas de mesures spécifiques ni des aides financières de l’Etat, considérables depuis 2021, l’apprentissage ne se développe pas. Il est totalement dépendant des financements de l’Etat, son essor est donc bien un choix politique, réalisé au détriment d’autres voies de formation.
Que ferait-on des élèves des LP si la formation professionnelle dépendait exclusivement de l’apprentissage ?
Je ne pense pas qu’il soit exclusivement question de dédier la formation des jeunes à l’apprentissage parce qu’en termes de gestion des flux, c’est impossible – et de coût pour les finances publiques. L’enseignement professionnel sert beaucoup à gérer les flux scolaires. C’est pour cela qu’il est démantelé, reconfiguré très régulièrement . C’est par la réforme Darcos de 2009, et le passage du bac pro de 4 à 3 ans sans passer par le BEP que la France a pu atteindre l’objectif des 80 % d’une classe d’âge au bac. L’intérêt de l’enseignement professionnel pour les responsables des politiques publiques, c’est qu’au nom de l’adéquation des diplômes à l’emploi, argument quasiment auto-suffisant, il est possible de les remanier sans cesse : augmenter ou réduire la durée du cursus de formation, imposer des stages ici et là et selon des périodes plus ou moins extensibles, restreindre ou valoriser tel ou tel enseignement. Grâce à ses diplômes, l’enseignement professionnel est très malléable et rend d’importants services, qu’il s’agisse d’élever le niveau général d’éducation, de massifier le nombre des bacheliers ou des diplômés, sans mettre en cause l’ordre éducatif et la hiérarchie des filières d’enseignement. Derrière l’argument impérieux de l’adéquation à l’emploi, ce sont d’autres objectifs qui sont in fine à l’origine des réformes.
Qu’est-ce que l’adéquation à l’emploi ?
C’est l’établissement de liens de proximité extrêmement étroits entre une formation, un diplôme et l’emploi visé. Sauf qu’il s’agit d’une fiction puisque les employeurs recrutent qui ils veulent, comme ils veulent, et que les jeunes qui sortent du système éducatif ne se précipitent pas non plus forcément vers les emplois et les secteurs d’activité pour lesquels ils ont été formés. En outre, ils ne représentent qu’entre 15% et 20 % des recrutements annuels, car le marché du travail est surtout alimenté par des salariés en activité qui changent d’emploi, des demandeurs d’emploi, des inactifs qui retournent à l’activité, etc. Par ailleurs, l’enseignement professionnel ne prépare pas qu’à l’emploi du coin, il a d’autres ambitions. Promouvoir l’adéquationnisme local, comme le fait le Président de la République, rappelle le temps des grands monopoles industriels qui embauchaient les jeunes à leurs sortie du système éducatif. Mais lorsqu’ils s’effondrent, ce sont des régions entières qui sont touchées, comme le montrent parmi d’autres les exemples du Nord ou de la Lorraine. Faut-il reproduire un tel modèle ?
Mais puisqu’il est question d’adéquation, il me semble important de rappeler que dans toutes les régions de France, les premiers employeurs sont les secteurs de la santé et de l’éducation : hôpitaux, écoles, collèges, lycées, universités… C’est aussi là que se situent les besoins en recrutement.
Propos recueillis par Caroline Renson