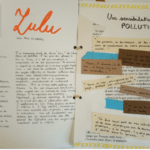Œuvre saisissante, « La Zone d’intérêt » de Jonathan Glazer sème le trouble dès sa présentation au festival de Cannes 2023 et…remporte le Grand Prix et le Prix Fipresci. La radicalité du sujet et l’audace des partis-pris de mise en scène, fruits de dix ans de travail documenté et réfléchi, ont de quoi glacer le sang des spectateurs les plus aguerris. Son argument : le commandant du camp d’Auschwitz, Rudolf Höss (Christian Friedel), sa femme Hedwig (Sandra Hüller) et leurs enfants habitent une belle villa avec jardin ensoleillé, fleurs aux couleurs pimpantes, domestiques, au bord d’une rivière arborée où il fait bon pique-niquer, à quelques mètres du camp de la mort, de l’autre côté du mur entourant leur résidence.
 Paradis visible, faux cloisonnement, enfer hors-champ
Paradis visible, faux cloisonnement, enfer hors-champ
Entrons donc dans « La Zone d’intérêt »- autrement dit la périphérie du camp selon la terminologie de recouvrement utilisée par les Nazis-, le paradis visible que s’efforce de construire la famille Höss. La vie domestique des bourreaux, imaginée par Jonathan Glazer à travers un scénario assez éloigné du roman éponyme de son compatriote Martin Amis, nourri par de nombreux éléments historiques, photographies de famille et mémoires de prison de Rudolf Höss comprises. Une existence, apparent paisible, totalement ritualisée (quotidien de la maîtresse de maison, dispensée des tâches ménagères par une servante silencieuse, regard baissé et menacée de ‘renvoi’ au moindre écart, un jardinier affairé, détente et bavardage, allongée sur un transat aux côtés de sa mère en visite, goûters entre amies autour d’un café, cocktails et autres réjouissances entre voisins du même bord…). Des jours en apparence sans accrocs, dans une routinière monotonie, formatée par l’architecture de la demeure à un étage, avec petit escalier d’entrée à balcon et attributs de luxe.
Un espace entièrement conçu par le cinéaste et son chef décorateur Chris Oddy, reconstitué non loin d’Auschwitz, au plus près du bâtiment d’origine occupé par la famille alors. Avec quelques principes directeurs : privilégier la géométrie rectiligne, les murs blancs, les nombreuses portes donnant sur des lieux dédiés au rez-de-chaussée et à l’étage. Une topographie d’ensemble permettant la mise en place conjointe de plusieurs caméras aptes à filmer en même temps les comédiens en action au fil des ‘événements’ ponctuant la journée, à charge pour le réalisateur et son directeur de la photographie, Lukasz Zal, d’en déceler les convergences et les dissonances. Avec la volonté de rester à distance (plans larges, travellings latéraux, pas de plans rapprochés sur les visages, par exemple…).
Dans ce micro-univers à l’atmosphère étouffante, renforcée par l’immuabilité des rituels du foyer, enregistrée au scalpel par ‘l’œil’ impassible de Jonathan Glazer, la scène inaugurale et idyllique du déjeuner sur l’herbe d’une famille ordinaire au bord de la rivière dans un nid de verdure prend des allures de tableau trompeur.
Quelques détails déroutants s’insinuent dans un plan ou une séquence et nous alertent sur cette normalité factice. Chez les Höss, dans la lumière claire, presque crémeuse, comme la peau des enfants blonds, il n’y a pas d’ombre. Jour blanc contre nuit noire pour la façade la maison avec ses trouées de lumière aux fenêtres s’éteignant les unes après les autres au fur et à mesure que le maître de maison vérifie et verrouille une par une toutes les portes. Et pourtant, dans le déni apparent des résidents, des signes de natures différentes (visuels et sonores surtout, événements de montage) se multiplient insidieusement, comme des indices d’une autre réalité, celle du camp, celle de l’entreprise génocidaire.
L’invisibilité en question, partis-pris réfléchi, enjeu historique et artistique
Nous ne pouvons nous en tenir à l’émoi manifesté par Hedwig lorsque son mari lui annonce la mutation pour le commandement d’un autre camp décidée en hauts lieux, laquelle implique le déménagement auquel cette dernière s’oppose catégoriquement, comme si risquait de s’effondrer alors l’aboutissement concret d’une ascension sociale.
Dans un autre espace-temps parallèle à ces petits tracas de ‘gens ordinaires’, la boucherie industrielle fonctionne à plein régime. Le haut mur entourant la propriété est surmonté de barbelés qui se laissent parfois deviner, comme le haut d’une cheminée et quelques furtives volutes de fumée…
Mais ce sont les bruits extérieurs à la demeure – des bruits venus d’ailleurs qui ne semblent pas atteindre les oreilles des résidents- , des bruits qui s’amplifient et se densifient progressivement d’un discret chant d’oiseau au cri prolongé d’un nourrisson jusqu’à des sons de plus en plus forts et enchevêtrés (hurlements brefs, cris déchirants ou coups étouffés, aboiements de chiens, claquements de fouet, coups de feu, tirs de mitraillettes…) au point de constituer un ‘tapis sonore’ suggérant l’indistinction, la défiguration et l’anéantissement des corps des victimes du massacre de masse. En un mélange sonore (concepteur sonore Johnnie Burn) dont la musique métallique ‘(composition de Mica Levi) accentue la dimension terrifiante.
Subtilité du montage, déchirures et béances dans la trame du temps linéaire
La singularité de la création tient également à l’agencement entre plusieurs séquences mêlant au montage (Paul Watts) des temporalités et des registres d’images différentes. Domine majoritairement le temps du présent de la fiction chez les Höss avec l’alternance du jour aveuglant de blancheur et de la nuit noire du sommeil des époux sans affect ni sexe. Parfois, un éclairage insolite surgit devant nos yeux : dans la pénombre du tunnel souterrain reliant la maison au camp, lieu de travail du commandant, la fiction nous le montre de dos lavant à grandes eaux son sexe après le viol subi par une déportée ; auparavant, nous assistons à une scène où la jeune fille assise sur une chaise, chaussures et vêtements défaits, face à lui relégué hors champ, lève le regard et rejette en arrière sa longue chevelure brune en un geste fugitif de défi. Une scène hallucinée comme si le cinéaste, pour un instant, sortait de la distanciation radicale pour redonner la grâce d’une figure humaine à la victime déjà détruite par le bourreau.
D’autres registres d’images surgissent encore introduisant des ruptures dans le présent dominant du couple nazi observé au quotidien. Ainsi, quelques images nocturnes filmées à la caméra infrarouge, d’une petite fille (une résistante proche du camp ? une déportée échappée ?) fouillant un amas de terre pour en extraire, semble-t-il, un morceau de papier enfoui en une séquence mystérieuse, étrangère à l’univers familial des Höss, et stimulant notre imaginaire tandis qu’un poème de déporté nous parvient lu en voix off.
Et un véritable ‘coup de force’ se produit alors que Rudolf Höss en petite forme (malaise et vomissements) descend le grand escalier avec rampe en fer forgé d’un bâtiment officiel où un supérieur lui apprend sa réaffectation au commandement d’Auschwitz. Un saut dans le temps jusqu’à aujourd’hui : par l’oeileton d’une porte fermée, celle du musée d’Auschwitz, nous voyons des employées nettoyer au jet les crematoriums puis un agent faire briller la surface de la vitrine derrière laquelle nous découvrons un monceau de chaussures entassées. Dans une pièce, les traces entretenues de la machine de mort des bourreaux, dans l’autre les restes visibles des Juifs exterminés. En une dérangeante cohabitation au sein d’un lieu mémoriel.
En réalité, « La Zone d’intérêt » ne nous accorde pas de repos puisque le film commence par un plan noir prolongé envahissant tout l’écran et se clôt par un plan du même type associé à une musique stridente aux sombres tonalités. Comme si la proposition cinématographique de représentation de la Shoah chez Jonathan Glazer reposait sur ces béances, ces trous noirs puisqu’il choisit de ne pas filmer les lieux spécifiques et les techniques criminelles pour mettre en œuvre la machine à exterminer.
Il convient de situer historiquement la démarche créatrice de Jonathan Glazer par rapport aux débats esthétiques et philosophiques suscités par la question de la représentation de la Shoah au cinéma, par le documentaire comme par la fiction, depuis « Nuit et Brouillard » d’Alain Resnais (1955) jusqu’au film de Laszko Nemes « Le fils de Saul » (2005) en passant notamment par « Shoah » de Claude Lanzmann (1985).
A ce titre, le dossier conçu par Parenthèsecinéma, exceptionnel par son amplitude et sa profondeur, contextualise des interrogations soulevées par ce film et les relie aux programmes d’enseignement pour les collégiens de 3ème et les lycéens en histoire-géographie et en philosophie tout en offrant des incitations à la réflexion à partir d’un choix pertinent de textes théoriques et de documents photographiques. Et la possibilité d’organiser des séances enseignants-élèves en liaison avec le cinéma le plus proche de l’établissement facilite l’accès à une œuvre dérangeante jusqu’au vertige.
Une œuvre radicale renouant avec la démarche fondatrice de Lanzmann
« La Zone d’intérêt » de Jonathan Glazer, 4ème long métrage d’un cinéaste britannique de 58 ans, mérite qu’on s’y attarde tant son geste cinématographique et ses partis-pris formels révèlent un acte de pensée longuement mûrie et une exigence renouant avec la démarche fondatrice de Claude Lanzmann. Loin des fictions, plus récentes, sur la Shoah et à fort potentiel émotionnel et compassionnel, Glazer choisit la suggestion effrayante du sort des victimes et l’évocation glaçante du quotidien ordinaire des bourreaux, le va-et-vient troublant entre le temps de l’horreur et du massacre de masse –qui hante toute la fiction- et d’autres perceptions et temporalités dont le temps d’aujourd’hui. Entre ce que nous pouvons VOIR et ce que nous devons SAVOIR, les accrocs dans la narration de « La Zone d’intérêt » font appel à notre imaginaire pour appréhender autrement la Shoah et sa représentation en 2023.
Laissons parler Claude Lanzmann [dans un texte sur son propre documentaire, éditions Belin, 1990 ; repris par l’historien d’art Georges Didi-Huberman dans « Phasmes, essais du l’apparition », Les éditions de minuit, 1998] : « Le pire crime, en même temps moral et artistique, qui puisse être commis lorsqu’il s’agit de réaliser une œuvre consacrée à l’Holocauste est de considérer celui-ci comme ‘passé’. L’Holocauste est soit légende soit présent, il n’est en aucun cas de l’ordre du souvenir. Un film consacré à l’Holocauste ne peut-être qu’un contre-mythe, c’est-à-dire une enquête sur le présent de l’Holocauste, ou à tout le moins une enquête sur un passé dont les cicatrices sont encore si fraîchement et si vivement inscrites dans les lieux et dans les consciences qu’il se donne à voir dans une hallucinante intemporalité ».
Samra Bonvoisin
« La Zone d’intérêt », un film de Jonathan Glazer-sortie le 31 janvier 2024
« Shoah » de Claude Lanzmann en accès libre pendant un mois sur le site france.tv