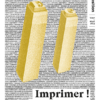« Pour mieux prévenir les atteintes à la laïcité, je souhaite également que le Conseil des sages de la laïcité et des valeurs de la République oriente ses travaux sur la question de la transmission des valeurs de la République et de leur partage dans le quotidien des écoles et des établissements » a annoncé le Ministre Pap Ndiaye lorsqu’il a introduit les cinq nouveaux sages de la laïcité et des valeurs de la République. « Le ministre a insisté sur la dénomination complète de ce Conseil » explique Alain Policar, sociologue et politologue, nouvellement nommé. Une nomination qui a fait des remous au sein du Conseil actuel. Son dernier livre qui attaque les anti antiracistes n’a sans doute pas aidé. « La laïcité n’est pas une loi qui combat la religion, c’est une loi pour la liberté de conscience. Faire de la laïcité une religion civile qui aurait pour but de combattre les croyances religieuses, en particulier l’islam, met en péril la communauté des citoyens et, dès lors, constitue un réel danger ». Alain Policar répond aux questions du Café pédagogique.
 Que signifie pour vous votre nomination ?
Que signifie pour vous votre nomination ?
Le ministre veut que le Conseil devienne un espace de débat, qu’il soit plus divers qu’il ne le fut. Il est donc normal qu’il fasse appel à des citoyens et citoyennes ayant une conception de la laïcité quelque peu différente de celle qui a prévalu jusqu’à présent. Si nous sommes tous attachés à la défense de principes fondamentaux, dont évidemment la liberté de conscience, je pense qu’il existe plus que des nuances dans l’appréciation de la question coloniale. C’est le nœud du problème. Mais rien n’indique que, parmi les nouvelles nominations, sur ce point comme sur bien d’autres, nous ayons la même approche.
On a, à tort, peu souligné que, parmi les nouveaux entrants, deux sont des juristes, et des juristes reconnus pour leurs compétences, l’une, Gwénaële Calvès, en matière de laïcité, l’autre, Thomas Hochmann, sur la question du négationnisme. Cet aspect importe beaucoup plus que ma nomination.
Je sais que celle-ci fait des remous. J’ai un peu de mal à les comprendre. Mais ils illustrent le rejet, par les médias de droite, de toute volonté de complexification. Car, je le dis avec force, je ne ressemble aucunement au portrait, que je lis ici ou là, faisant de moi un défenseur du multiculturalisme normatif et, cerise sur le gâteau, un anti-universaliste. Je passe sur les accusations de « wokisme » qui ne sont que l’expression de la panique morale qui transforme les chercheurs attentifs aux discriminations fondées sur les identités raciales en complices de l’extrémisme religieux, voire du terrorisme islamiste. Dès que notre position diverge de la position mainstream, on est accusé de haïr les valeurs occidentales, de se vouer à la destruction de notre « civilisation ».
Il suffit donc d’avoir un point de vue tant soit peu marginal sur l’appréciation de la politique menée pour être étiqueté. Et toute volonté de rejeter l’étiquette ne fait que renforcer le soupçon. C’est à peu près le même mécanisme que la rumeur : plus vous vous en défendez, plus, dans l’esprit du public, vous la corroborez. On a pu récemment l’observer lors du procès en islamo-gauchisme instruit par les ministres Blanquer et Vidal. Tout cela participe à l’appauvrissement du débat intellectuel, ce qui est très préoccupant. Ce type de raccourci crée les clivages et fige les positions. Je ne nie pas que nous ayons des divergences, Dominique Schnapper et moi, mais elle sait que cela ne diminue en rien mon admiration pour son œuvre.
En quoi vos positions divergent tant de celles du Conseil actuel ?
Certains des membres actuels du Conseil de la laïcité et des valeurs de la République pratiquent, à mon sens, ce que Michael Walzer avait nommé l’universalisme de surplomb. On impose aux autres nos façons de faire, et on considère notre modèle comme devant s’imposer, quoi que puissent en penser les populations auxquelles nous sommes supposés apporter la lumière. On passe ainsi par pertes et profits ce à quoi cet universalisme-là, celui que Césaire nommait décharné, a conduit, à savoir le crime colonial au nom de notre « mission civilisatrice ».
A cet «universalisme », j’oppose l’universalisme latéral, selon l’expression de Merleau-Ponty, expression qui peut être traduite, ce que fit Césaire, par universalisme pluriel. Aujourd’hui, on en trouve une version attrayante chez Souleymane Bachir Diagne, qui est, notamment, un philosophe du postcolonialisme, à l’instar, entre autres, de Fanon, Glissant ou Memmi.
Vous pensez donc pourvoir apporter votre contribution malgré les divergences ?
Oui car, je tiens à le souligner, l’atmosphère du 14 avril était plutôt apaisée. Ce premier moment laisse supposer que nous réussirons à travailler ensemble, dans un esprit de concorde.
J’espère montrer, tout d’abord, que les positions que je défends ne sont pas anti-laïques, qu’elles sont parfaitement conformes, à la philosophie de la laïcité, telle qu’elle résulte de la loi de 1905. Une laïcité libérale, une laïcité de pacification fondée sur le principe de séparation des églises et de l’État et promouvant la liberté de conscience. En d’autres termes, un principe juridique et non une valeur identitaire. Tout indique que cette orientation est défendue par d’autres que moi au sein du Conseil.
Je ne sais pas comment les choses se passeront, mais je crois fondamentalement aux vertus de l’argumentation. Et aussi au fait que les dissensions prennent une autre coloration lorsque l’on passe de la confrontation des textes à la rencontre du visage d’Autrui. Il me semble que cette référence levinasienne est de nature à nous rassembler.
Et, il faut y insister, Pap Ndiaye souhaite que le champ du Conseil ne se limite plus aux questions touchant au respect de la laïcité. Il tient à ce que l’on s’intéresse aux discriminations, au racisme – y compris à l’islamophobie, car, même si ce terme est rejeté par certains, il est désormais, qu’on s’en réjouisse ou non, entré dans le vocabulaire des sciences sociales – à l’antisémitisme, aux principes de la République.
L’existence même d’un tel Conseil est-elle justifiée selon vous ?
On pourrait, et sans doute certains ne manquent pas de le faire, se gausser de ce terme de sage et de la prétention qui lui est attachée, à l’expertise sur un sujet brûlant. Il est clair pour moi que nous n’exerçons pas un quelconque magistère moral.
Cela étant, il me semble nécessaire qu’il existe des structures, des instances pour accompagner les équipes confrontées sur le terrain à de réelles difficultés – même si l’âge moyen des conseillers fait que la plupart d’entre eux, j’en fais partie, ne les ont pas connues. Il est important de faire l’inventaire de ces difficultés, mais aussi de réaffirmer l’idée, et de tout faire pour l’encourager, de l’importance du savoir, de son rôle libérateur. Idéal qui doit être guidé par celui d’égalité, au sens où nul ne peut être dispensé, pour une raison, fût-elle religieuse, de l’apprentissage des savoirs communs. Il existe des principes universalisables, le plus important sans doute étant celui d’égalité entre les sexes. Et, dans ce domaine, beaucoup reste à faire.
On doit néanmoins rester lucide sur l’influence que ce Conseil peut avoir. Certes, il rend des avis. Mais leur sort est lié à la façon dont le pouvoir politique jugera de leur utilité. Peut-être le fait que le Conseil voie son action strictement définie par le ministre donnera-t-il une plus grande chance à ces avis d’être suivis ?
Mais votre question dépasse très largement ce cas particulier : quel rôle nos écrits, lorsqu’il ne s’agit pas de sciences expérimentales, peuvent avoir sur les comportements. Comme l’écrivait Pascal, nous sommes, en tant qu’humains, « perdus dans un canton de l’univers ».
Propos recueillis par Lilia Ben Hamouda