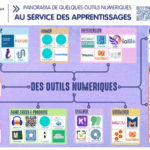« On a appris à vivre le deuil ensemble ». Comment l’École a-t-elle vécu la double vague d’attentats de 2015, Charlie en janvier, Bataclan en novembre ? Historien des rapports entre l’École et les guerres, Emmanuel Saint-Fuscien étudie les réactions officielles et sonde les âmes des responsables, des enseignants et des élèves dans un livre, L’école sous le feu (éditions Passés composés) qui fait date. De janvier à novembre 2015, une culture de guerre s’est installée dans les établissements, professeurs et élèves apprenant à débattre et faire deuil ensemble. Sept ans après, que reste-t-il de ces accommodements ? Emmanuel Saint-Fuscien en débat avec le Café pédagogique.
Vous êtes un spécialiste des relations entre l’école et la guerre au XXe siècle. Comment en êtes-vous arrivé à travailler sur l’école et les attentats de 2015 ? Le parallèle avec la guerre, auquel renvoie le titre de votre livre « l’école sous le feu », est-il valable ?
 C’est d’abord l’événement qui fait effraction. En 2015, j’animais un séminaire à l’EHESS sur ces liens entre école et guerre. Non seulement sur la façon dont l’école représente la guerre. Mais aussi sur la façon dont la guerre transforme l’école jusqu’en sortie de Seconde Guerre mondiale. En 2015, après les attentats, on a vu se déployer des concordances avec les questions que nous soulevions avec un petit groupe d’étudiants. Par exemple, le fait de rendre l’école coupable des déliaisons, de provoquer des tensions singulières dans les relations entre élèves et enseignants, de mettre en circulation des émotions dans l’espace scolaire. Ce qu’on étudiait à l’aune de la Grande Guerre, de la Guerre d’Espagne ou de la Seconde Guerre mondiale, surgissait d’une certaine façon dans les propos politiques ou médiatiques sur l’école. Et on a vécu cela à nouveau, mais différemment, en novembre 2015 avec les cérémonies d’hommage dans les cours de récréation de milliers d’établissements, semblant faire écho à celle organisée par la Présidence de la République dans la cour de la Sorbonne devant des élèves du secondaire placés au premier rang du public filmé par les caméras et incarnant l’implication de l’école dans l’épreuve nationale.
C’est d’abord l’événement qui fait effraction. En 2015, j’animais un séminaire à l’EHESS sur ces liens entre école et guerre. Non seulement sur la façon dont l’école représente la guerre. Mais aussi sur la façon dont la guerre transforme l’école jusqu’en sortie de Seconde Guerre mondiale. En 2015, après les attentats, on a vu se déployer des concordances avec les questions que nous soulevions avec un petit groupe d’étudiants. Par exemple, le fait de rendre l’école coupable des déliaisons, de provoquer des tensions singulières dans les relations entre élèves et enseignants, de mettre en circulation des émotions dans l’espace scolaire. Ce qu’on étudiait à l’aune de la Grande Guerre, de la Guerre d’Espagne ou de la Seconde Guerre mondiale, surgissait d’une certaine façon dans les propos politiques ou médiatiques sur l’école. Et on a vécu cela à nouveau, mais différemment, en novembre 2015 avec les cérémonies d’hommage dans les cours de récréation de milliers d’établissements, semblant faire écho à celle organisée par la Présidence de la République dans la cour de la Sorbonne devant des élèves du secondaire placés au premier rang du public filmé par les caméras et incarnant l’implication de l’école dans l’épreuve nationale.
Entre janvier et novembre 2015, un discours dépréciateur inédit s’est déployé contre l’école alors que l’école est la seule institution qui réunit des adultes avec un haut niveau de formation et tous les enfants des classes populaires. Après les attentats de janvier 2015, on a eu la surprise de voir l’école accablée de tous les maux. Elle était coupable d’avoir failli à corriger les inégalités ou d’avoir toléré des empiètements à la laïcité, coupable d’immobilisme, coupable de silence, coupable de violences. Et en son sein, certains élèves étaient coupables, aux yeux de beaucoup de commentateurs. On a parfois associé des élèves de 12 ans à des terroristes, par exemple dans le rapport de la commission d’enquête sénatoriale remis par J. Grosperrin au Président de la République en juillet 2015.
L’expression « l’école sous le feu » est-elle valable ?
Elle était sous le feu des terroristes de Daesh qui ont annoncé leur intention d’attaquer les écoles. Et elle était (et demeure) sous le feu de nombreuses critiques, coupable d’avoir formé des terroristes et d’une forme de compromission face au radicalisme. Au passage, on retrouve un lien classique des relations entre l’école et la guerre dans le XXe siècle guerrier : l’école est toujours coupable en temps de guerre. En 1940 de la défaite. En 1918, du coût de la victoire. Pendant la guerre d’Algérie, les deux camps s’en prenaient à l’école : le FLN attaquait l’école coloniale et l’OAS l’accusait d’être anticolonialiste, les deux organisations perpétrant des attentats contre les établissements incluant le meurtre d’enseignants et d’inspecteurs dans le cas de l’OAS
En 2015, il y a deux attentats. Et d’abord en janvier, celui contre Charlie. Comment s’est imposée l’idée de faire une minute de silence dans les écoles ? Pourquoi lui imposer alors qu’a priori, elle n’est pas concernée ?
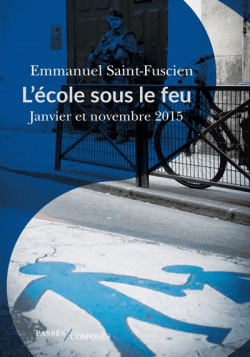
Cela entre – une fois encore – dans la continuité des liens entre école et guerre. Parce qu’elle a en charge, en France, de former les citoyens, l’école fut massivement associée au deuil de guerre en France. En 1914-18, les Anglais et les Allemands avaient déscolarisé un nombre important d’élèves. En France, l’état les a maintenus en classe, mais avec l’injonction de participer au deuil de la nation (œuvre des tombes, participation aux cérémonies de deuil…). On a retrouvé cette idée jusqu’au XXIe siècle, par exemple dans la volonté de N Sarkozy de confier, en 2008, à chaque élève de CM2, la mémoire d’un enfant déporté. En 2015, le gouvernement décrète une minute de silence le 7 au soir pour le 8 à midi, y compris dans les écoles primaires. Comme si les élèves devaient, par l’hommage aux morts, soutenir le deuil de la nation. Mal préparées, ces minutes de silence ont été vécues de manière douloureuse en janvier. Les autorités académiques en avaient très mal évalué les formes et les risques.
Comment ont réagi les enseignants à cette injonction ?
En janvier 2015, l’administration a réagi avec une semaine de retard et ne l’a jamais rattrapé. Les attentats ont produit un choc énorme chez les enseignants, proches de Charlie – ou peut-être davantage de son passé – profondément associé à une culture de gauche. Alors que les élèves de milieu populaire ne connaissaient pas Charlie Hebdo et n’ont ressenti, contrairement à certains enseignants, aucune perte intime. Les professeurs se sont sentis seuls face à l’épreuve. Ils attendaient un moratoire de la vie scolaire qui n’a pas eu lieu. L’administration ne les a pas épaulés. Seuls, ils ont dû faire face à leurs élèves et aux écarts générationnels et culturels qui se rappelaient brutalement à eux. Cela a été d’autant plus mal vécu lorsque l’écart s’est révélé entre eux et des élèves auxquels ils étaient attachés, des élèves avec qui ils avaient une relation pédagogique solide. De leur côté, les élèves ont été surpris des réactions des professeurs, ne les reconnaissant pas. Tout s’est passé comme si le pacte pédagogique venait de se casser.
En novembre, il y a de nouveaux attentats. Et là, vous expliquez dans le livre que se produit une rupture. Laquelle ?
L’indétermination des victimes et les lieux des attentats (notamment l’objectif du stade de France de Saint-Denis) ont créé des différences, c’est certain. Mais par ailleurs, le livre avance qu’entre janvier et novembre, les enseignants et leurs élèves ont apporté de multiples corrections – silencieuses ou non – aux tensions provoquées par les incidents de la minute de silence du 8 janvier. Une pédagogie spécifique, souvent, s’est déployée entre janvier et novembre. En novembre, tout le monde est attentif à la façon dont on va vivre sa peine et ses croyances dans les enceintes scolaires et les uns et les autres ont à cœur de ne pas reproduire les fractures de janvier. On a appris à vivre le deuil ensemble. C’est ce que disent, globalement, les professeurs et les élèves que j’ai interrogés.
Peut-on dire que les attentats ont eu un effet durable sur le pacte éducatif ?
C’est difficile de mesurer aujourd’hui des effets durables. D’autant que d’autres épreuves ont eu lieu, les fermetures pendant le confinement notamment et bien sûr l’assassinat de Samuel Paty. Certains disent qu’il ne reste rien des ajustements pédagogiques qui ont eu lieu en 2015 car l’école est une institution tellement codifiée qu’elle revient à sa routine. D’autres disent que tout a changé. L’histoire de l’éducation montre souvent que les variations des vies scolaires liées aux épreuves brutales peuvent s’effacer lors du « retour à la normale » mais qu’il en reste toujours une mémoire agissante. Je pense que c’est le cas.
Y a-t-il une pédagogie post attentats ?
C’est difficile à dire. L’invitation à débattre était déjà dans les programmes d’EMC mis en place le 5 janvier, quelques jours avant les attentats. Du coup, les enseignants ont cru qu’ils devaient inviter les élèves au débat alors que le meurtre brutal de journalistes pamphlétaires n’appelait aucun débat dans le cadre d’une salle de classe, notamment lorsque les élèves ne comprenaient pas l’émotion de leurs professeurs. « Les professeurs voulaient un débat, mais quand on donnait notre avis, on était sanctionné ou invité à se taire » nous disent certains. D’autres élèves purent profiter de ces « impossibles » débats en salle de classe pour sciemment subvertir les intentions d’unanimisme attendues par l’institution. En revanche, plus tard, les échanges furent possibles. Beaucoup sont parvenus à évoquer des différences avec des arguments que tous purent entendre sans remettre en cause l’ordre scolaire.
Sept ans après ces attentats, l’école est encore au centre du débat national, par exemple avec le débat sur l’uniforme pour imposer l’intégration des élèves soupçonnés de communautarisme. Ce sont 7 années perdues pour l’école ?
La difficulté est toujours la même. Les discours sur l’école énoncent des généralités alors qu’il y a 900 000 professeurs et des millions d’élèves. Une enquête menée en 2015 dans l’académie de Grenoble, notamment par Sébastien Roché sur les adolescents et la loi, montre par exemple que quand on les classe par confessions, ce sont les élèves musulmans qui disent avoir le plus confiance en l’école. On assiste de nouveau à des tensions à propos de la question des vêtements dans certains établissements, mais est-ce que cela ne s’accompagne pas de discussions moins conflictuelles dans d’autres ? La parole politique écrase la multiplicité des expériences sociales faites en classe et les enquêtes en sciences sociales manquent, étonnamment, pour en établir les différentes formes et leur proportion.
Propos recueillis par François Jarraud
Emmanuel Saint-Fuscien, L’école sous le feu. Janvier et novembre 2015. Éditions Passés composés, ISBN 978-2-3793-3291-3, 20€.