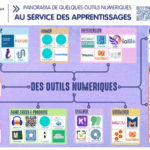Le cri d’alarme de cette jeune enseignante de SVT soulève de nombreuses questions à la lecture des futurs programmes dispensés au lycée. Pour Justine Renard, enseignante stagiaire de SVT au lycée international Europole de Grenoble, « la configuration et le contenu des programmes de 2nde ne permettent que d’effleurer la question environnementale ». La spécialisation précoce des élèves en 1ère est aussi à l’origine aujourd’hui « de nombreuses décisions politiques ou démarches industrielles délétères pour notre environnement et notre santé ». Justine Renard questionne l’impact environnemental des nouvelles technologies et plaide pour « un modèle de réussite collective qui s’assure que nos besoins soient assurés dans des conditions durables et viables pour tous ».
Quel regard avez-vous sur les nouveaux programmes de SVT dispensés en seconde ?
 Le programme est très dense en seconde : il touche à la fois l’organisation fonctionnelle du vivant de la cellule à l’échelle des écosystèmes, abordant à la question de la biodiversité et de son évolution, d’enjeux contemporains sur la dynamique des sols et sur les agrosystèmes, de la procréation et du lien entre les microorganismes et notre santé. Il s’agit donc d’un programme équilibré entre apprendre ce qu’est le vivant, explorer les enjeux environnementaux concernant l’agriculture et les sols et des questions liées à la santé.
Le programme est très dense en seconde : il touche à la fois l’organisation fonctionnelle du vivant de la cellule à l’échelle des écosystèmes, abordant à la question de la biodiversité et de son évolution, d’enjeux contemporains sur la dynamique des sols et sur les agrosystèmes, de la procréation et du lien entre les microorganismes et notre santé. Il s’agit donc d’un programme équilibré entre apprendre ce qu’est le vivant, explorer les enjeux environnementaux concernant l’agriculture et les sols et des questions liées à la santé.
Néanmoins, au regard notamment des défis environnementaux auxquels nous faisons face, l’ensemble ne pèse pas lourd sur l’emploi du temps d’un élève de seconde. En effet si l’on ramène la répartition annuelle du programme à une semaine, l’élève consacrera en moyenne 20 à 25 minutes par semaine de son emploi du temps aux questions environnementales sous l’angle des Sciences de la Vie et de la Terre, encore qu’une grande partie n’abordera pas les problèmes environnementaux en tant que tels.
Pour moi, ceci minimise profondément leur importance au vu de l’urgence à laquelle nous faisons face. En effet notre système agricole repose entièrement sur le pétrole, entretenant une dépendance énergétique forte vis-à-vis des fournisseurs. Notre modèle agricole prédominant est particulièrement vulnérable aux changements climatiques et notamment aux épisodes de sécheresse et de canicule alors que lui-même est l’un des principaux secteurs émetteurs de gaz à effet de serre. L’effondrement de la biodiversité que nous vivons depuis plusieurs décennies aura par ailleurs un impact fort sur son rendement, entre autre lié à la disparition des insectes pollinisateurs. De plus, il est à l’origine de pollutions qui impactent notre santé et notre environnement. Si l’on ajoute à cela la crise économique et sociale qui frappe actuellement le secteur agricole en France, on comprend que nous sommes dans une position de vulnérabilité extrême quant à notre capacité à nous nourrir demain.
Il est donc fondamental que chaque élève s’empare de cette préoccupation et prenne conscience qu’il s’agit d’une priorité, quelle que soit son orientation future. Mais la configuration et le contenu des programmes en secondes ne permettent que d’effleurer la question et entretiennent non seulement une forme d’inconscience chez les élèves mais en plus ne leur met pas en main les clés pour changer leur mode de consommation et envisager des alternatives de production, pourtant déjà existantes (agro-écologie et permaculture notamment).
Pour moi, accorder une place centrale à l’étude du vivant et à nos impacts sur les écosystèmes, c’est comprendre la valeur réelle qu’a la nature dans notre quotidien, son rôle dans notre capacité à nous alimenter et à vivre en bonne santé et donc permettre de l’intégrer dans son mode de vie et dans ses démarches professionnelles.
Et en 1ère ?
Les élèves de première n’ayant pas choisi la spécialité SVT ne bénéficieront donc que du tronc commun de sciences, réparti en une heure hebdomadaire de physique-chimie et une heure hebdomadaire de SVT. On peut imaginer que les profils des élèves concernés seront principalement ceux qui souhaitent s’orienter vers des études de sciences économiques et sociales, de littérature voire en ingénierie technologique et numérique, c’est-à-dire une proportion importante.
Or le programme commun de sciences ne traite absolument pas des questions environnementales ou de santé. Pour moi, ceci est le début d’une spécialisation trop précoce qui a déjà fait ses ravages les décennies précédentes et qui a probablement mené à de nombreuses décisions politiques ou démarches industrielles délétères pour notre environnement et notre santé. Car avec une meilleure connaissance du vivant et en comprenant mieux le lien entre la santé des écosystèmes et notre capacité à subvenir à nos besoins, nous n’aurions aucun intérêt à prendre des décisions qui, ajoutées à d’autres, mettraient en péril notre survie collective. Réduire l’étude de ces questions dans les programmes, c’est entretenir l’illusion que notre société fonctionne indépendamment de l’état de santé des écosystèmes, des ressources, pourtant limitées voire quasiment épuisées et c’est sous-estimer les impacts que pourraient avoir les changements environnementaux globaux et locaux sur la durabilité de notre société.
Les élèves qui auront choisi la spécialité de SVT aborderont les questions des écosystèmes et des services environnementaux sur une partie de leur programme. Mais pour les raisons évoquées plus haut, cela ne devrait pas faire l’objet d’une spécialité mais être abordé par tous.
En quoi faudrait-il reconsidérer les nouvelles technologies pour leurs effets sur l’environnement ?
Pour ces questions, je vous renvoie, entre autres, aux travaux de Françoise Berthoud et du groupe GDS EcoInfo. En résumé, il s’entretient une première forme de mythe dans notre société, qui laisse penser que le numérique c’est un progrès par rapport à l’environnement parce que, par exemple, ceci permettrait de réduire la consommation de papier, de faire du télétravail, d’améliorer notre efficacité énergétique…
Mais derrière ce côté immatériel se cache une réalité dont nous entendons rarement parler. Ordinateurs, réseaux, datacenters représentent 10% de la consommation électrique mondiale, soit 4% de l’émission de gaz à effet de serre. Par ailleurs c’est sous-estimer profondément l’impact environnemental des technologies qui ne peut se résumer à la consommation énergétique. Il y a un avant achat (prélèvement de matières premières responsable de la déforestation, transformation énergivore, transport émetteur de gaz à effet de serre…) et un après (gestion des déchets souvent très nocifs pour l’environnement et notre santé). Et tous ces problèmes sont décuplés par des effets rebonds qui se traduisent en partie par le fait que la demande augmente. D’une part par diminution de leur prix qui favorise leur renouvellement et d’autre part, par l’augmentation de la proportion de la population mondiale qui a accès à ces technologies. Outre les externalités négatives générées, nous serons nécessairement limités à un moment ou un autre par l’épuisement des ressources. L’ADEME dans « L’épuisement des métaux et minéraux, faut-il s’inquiéter ?» parle d’un épuisement de certaines matières minérales employées pour la conception de technologie numérique d’ici à 10ans et souligne que le recyclage ne suffira pas à combler la demande.
Pour les technologies relatives à la transition énergétique (panneaux solaires, éoliennes…), il faut savoir que pour le moment la production énergétique mondiale repose encore à 81,4% sur des énergies fossiles, selon des chiffres de l’Agence Internationale de l’Energie. Eolien, géothermie, solaire ne représentent qu’1,5%. Or développer ces énergies « renouvelables » c’est produire des technologies et donc utiliser matériaux et énergie. Il faut également trouver des solutions pour le stockage de ces énergies intermittentes et donc créer des batteries qui elles même reposent sur des minéraux et métaux épuisables….
Ajoutez à ces constats le fait que la population mondiale augmente et, selon l’ONU, atteindra près de 10 milliards en 2050 et 11 milliards en 2100. Pour ma part, la démonstration est faite. Nous ne pouvons pas nous en remettre seulement aux technologies pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Le développement d’énergies renouvelables est certes important, mais nous ne pouvons-nous en contenter sans renoncer à une forme de confort de vie en parallèle. Aujourd’hui en France, il nous faudrait l’équivalent des ressources de 3 planètes pour continuer sur ce rythme de vie (chiffre donné par le Global Footprint Network). Les pays émergents suivant notre modèle de développement et donc de consommation, vous réalisez encore plus que ce n’est pas soutenable.
Pour toutes ces raisons, je pense qu’il est dangereux d’entretenir le mythe de la technologie salvatrice et je pense qu’il est fondamental que l’on questionne dès aujourd’hui la place des technologies dans nos vies qui parait incompatible avec une démarche de sobriété énergétique, pourtant indispensable à la perspective de ce qui a été évoqué. De fait, je me pose des questions concernant la création du nouvel enseignement Sciences Technologiques et Numériques qui vise à l’acquisition de compétences sur l’utilisation et le fonctionnement de ces technologies. Mais il n’amène pas à s’interroger sur leur impact environnemental et les pénuries auxquelles nous allons être bientôt confrontées si l’on continue dans ce sens.
Pourquoi est-ce important que l’école reste un lieu d’expérimentation ?
Pour être encore en formation, je me rends compte que beaucoup d’efforts sont faits pour intégrer de nouvelles méthodes pédagogiques reposant sur des travaux de neurologie, de sciences sociales ou encore de didactique dans notre pratique d’enseignement et de donner les mêmes chances aux élèves, malgré leur diversité. Pour cela je suis agréablement surprise car je partais avec un apriori négatif.
Néanmoins, je ne peux m’empêcher de me dire que la situation actuelle de notre société, sociale et environnementale, est une forme d’échec de notre système scolaire. Malgré la volonté d’éveiller l’esprit critique des élèves, de les placer dans une démarche de citoyen, de leur donner une « égalité des chances » notre modèle scolaire est un modèle de réussite centré sur l’individu, caractérisé par ses notes, son orientation, son nombre d’années d’étude… et non un modèle de réussite collective qui s’assure que nos besoins soient assurés dans des conditions durables et viables pour tous. Or c’est quelque chose qui se perpétue dans le monde professionnel qui façonne la société dans laquelle nous vivons.
Avec les enjeux environnementaux et sociaux actuels, on parle désormais de l’importance de changer de paradigme, à savoir de construire une nouvelle société fondée sur la sobriété et la coopération. Je pense que l’école est un endroit idéal pour initier ce changement. Mais pour cela, il faut aussi repenser nos objectifs d’éducation et les valeurs que nous souhaitons prioriser.
Quels sont les retours que vous avez de votre hiérarchie avec laquelle vous partagez vos écrits ?
Je n’ai eu jusqu’à présent aucun retour de l’inspection académique. En revanche, j’en ai eu de la part de collègues et de formateurs qui sont plutôt d’accord avec les questions que je soulève. Mais il en est ressorti que chacun se sent un peu dépassé par des rouages sur lesquels nous n’avons pas de prise du fait de l’organisation très verticale sur laquelle repose les réformes. Certaines associations d’enseignants ou des syndicats sont porteurs de revendication mais leur impact semble faible d’un point de vue décisionnel. Chacun s’en remet donc à ce qu’il peut à savoir enseigner le programme en modulant ses approches en fonction sa sensibilité et son expérience tout en veillant son devoir de réserve et à sa neutralité…
En quoi votre parcours personnel et professionnel font-ils sens concernant votre engagement actuel ?
Je pense qu’avoir un père agriculteur et avoir été confrontée à la réalité du monde agricole m’a forcément beaucoup sensibilisée à ces problématiques. Néanmoins, malgré une orientation en sciences de la vie et de la Terre, ainsi qu’une maitrise en écologie et biodiversité, je n’ai connu mon éveil « écologique » que très tardivement et de manière peu commune. J’ai profité d’une année de césure pour partir en voyage et faire de l’éco-volontariat en Bolivie. J’ai pu y rencontrer des personnes très inspirantes aux parcours variés et qui m’ont ouverte à la possibilité d’imaginer un autre modèle de vie. Mais le déclic est principalement venu après avoir été spectatrice d’une forme de destruction culturelle et environnementale liées à l’occidentalisation de ce pays.
Ceci m’a profondément marquée, m’a amenée à me renseigner davantage sur ces questions (même si je suis loin d’être exhaustive), facilité par le fait que le monde scientifique ne m’était pas inconnu du fait de mes études à l’ENS de Paris et par mes connaissances en Sciences de la Vie et de la Terre. Depuis je me suis engagée à informer et sensibiliser autant que je pouvais. Ceci s’est d’abord fait par le biais de l’animation, en tant qu’éducatrice à l’environnement. Désormais, j’essaie de le faire à travers ma très récente profession d’enseignante mais je ne peux m’empêcher de constater un décalage entre ce que je connais et ce que j’enseigne. Malheureusement, il ne s’agit pas d’un simple décalage idéologique mais d’une forme de décalage de conscience. Cet inconfort est probablement le principal moteur dans ma démarche actuelle.
Entretien par Julien Cabioch
Les ressources évoquées dans l’interview :
Effondrement de la biodiversité
Dans le café
SVT : Des programmes de lycée plus difficiles ?
SVT et sciences : Quelles nouveautés dans les futurs programmes?